| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
Galerie de peinture mauricienne
Galri lapintir morisyen
Voyage pittoresque autour du Monde
M. Dumont D'Urville
Capitaine de vaisseau
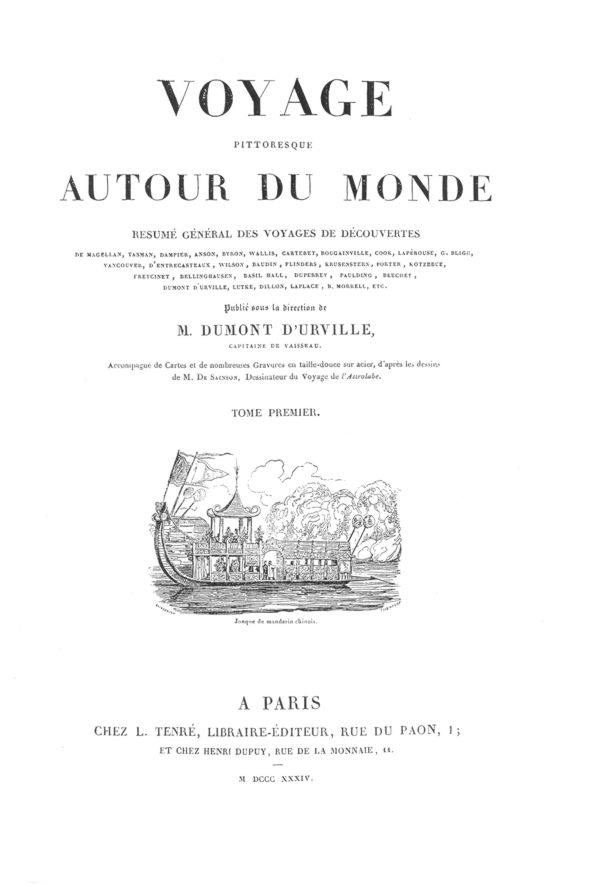 |
 |
... aux colons la juridiction anglaise; ils ont fondé entre l'Inde et le Cap un point de relâche et de ravitaillement. Que peuvent-ils souhaiter de plus? Aux vaincus maintenant quelques consolations de colère; au captif le plaisir de gronder et de mordre sa chaîne. Cela sert aux nouveaux maîtres et les dispense d'être justes. Il y a là un motif d'excuse pour le despotisme fiscal, qui se fait payer en belles piastres sa tolérance pour les rancunes françaises.
Je n'étais pas étranger à Port-Louis, j'y avais un ami, un Languedocien qui, fixé dans l'île depuis 1817, y avait organisé un train d'affaires lucratives. Verger, c'est son nom, m'accueillit par un cri de surprise, et courut dans mes bras. Bon et jovial garçon, avec ses trente années de vie nomade, ruiné en France par des fripons, il avait recommencé sa fortune à Port-Louis. Il s'y était installé au quartier du Rempart, dans une maison délicieuse, dont une jolie mulâtresse faisait les honneurs. Sa Clara était charmante; il l'avait prise par caprice; il l'avait conservée par amour. Entre eux ce lien avait pris la valeur d'un mariage légal; les préjugés coloniaux n'admettent rien au-delà. Blanche presque autant qu'une Européenne, grande, admirablement faite, elle s'était créé en outre quelques ressources d'éducation. Elle touchait du piano, dessinait, causait littérature et romans comme le pourrait faire une Parisienne.
Je m'installai dans la maison de mon ami; on me donna un pavillon au fond du jardin, un noir à mes ordres, et une Malabare pour prendre soin de ma garde-robe. Un sultan n'eût pas été mieux traité. La maitresse de la maison alla même jusqu'à m'envoyer son palanquin, espèce de litière garnie de coussins, où l'on peut s'allonger et dormir au chant des nègres qui la portent. Mais j'étais encore trop Européen pour user de ce dernier raffinement du sybaritisme créole. D'ailleurs, je voulais voir à mon aise, marcher ou stationner à mon gré; et mes allures d'observateur se seraient peu accommodées de ce mode de transport, quand même je n'aurais pas eu de la répugnance à me sentir voituré sur des épaules d'hommes.
Dans le mois où nous étions, la chaleur est excessive à l'Île-de-France, et il fallut renoncer à mes habits de drap. Pour les premiers jours, mon ami se chargea de ma toilette. Vestes, pantalons, gilets de percale blanche, renouvelés deux ou trois fois par jour; large chapeau de feutre gris, cravate flottante, tel était l'uniforme créole, propre, commode, élégant. Je m'y fis sans peine: on eût juré, quand je sortis avec mon hôte, que j'habitais la colonie depuis de longues années.
Port-Louis se divise en ville proprement dite et en quartiers ou camps. Le camp malabare est peuplé d'Indiens; le camp libre de mulâtresses. De tous les monuments de la ville, les seuls qu'on puisse remarquer sont la caserne construite par les Français et l'aqueduc qui conduit les eaux, par-dessus un ravin profond, depuis la grande rivière jusqu'à la ville, ouvrage en pierre et en brique que l'on doit au gouverneur Labourdonnais. Le château du gouvernement est destiné à s'en aller en pièces par un beau jour de tempête: bâti en fer-à-cheval, formé de charpentes qui chaque jour se disjoignent, humide, incommode, mal meublé, c'est le plus détestable séjour qu'on puisse imposer à un fonctionnaire. Aussi le général Colleville, alors administrateur de la colonie au nom des Anglais, demeurait-il de préférence dans sa charmante villa du Réduit, habitation fraîche et ombragée, avec des parterres de fleurs, des cascades, des boulingrins et des quinconces.
Dans la même journée nous pûmes voir toute la ville. Notre première course fut pour le quartier qu'un incendie dévora en 1816: c'était le plus beau, le plus riche de Port-Louis. Les magasins les mieux approvisionnés, les plus belles études de notaires, les hôtels les plus somptueux et une magnifique bibliothèque publique, tout s'abîma dans une nuit. Au jour il n'en restait plus que quelques murailles noircies. Malgré le secours des pompes, l'affluence des colons, le dévouement des noirs, on ne put rien sauver. Une seule maison de commerce, M. Bonhomme, perdit 30’000 barriques de vin; des cargaisons de riz et de sucre, des dépôts de soieries d'Europe et de châles de l'Inde, des masses d'indigo et de thé, se réduisirent à quelques monticules de cendres.
Aujourd'hui encore le dommage est à peine réparé; et la rue qui longe le rivage est la seule qui ait repris un air de fête et d'opulence. Ses petites maisons, à un seul étage, peintes de différentes couleurs, avec leurs treillis verts et leurs bouquets de bois noir ou de cocotier: forment encore un des plus jolis alignements que l'on puisse voir. Plus loin, et toujours au bord de l'eau, se groupent des demeures de plus grande apparence, plantées d'avenues et pourvues de jardins. Ce sont, pour la plupart, des lieux de délassement et de retraite, où le négociant vient respirer vers le soir les brises du large et se reposer du tracas des affaires.
Du quartier brûlé, mon hôte me conduisit au quartier de la Douane, où s'opérait le débarquement des marchandises. C'est une place assez étroite, couverte de quelques baraques de préposés et toujours enveloppée d'un nuage de poussière. Là, deux ou trois cents noirs déchargeaient des accons et des chaloupes. Ces esclaves, presque tous Malgaches ou Mozambiques, portaient sur le dos de larges sillons où les verges du rotin avaient inscrit leur date. Les uns frais et saignants encore, les autres cicatrisés ou suppurants, témoignaient que ces malheureux recevaient des corrections à peu près quotidiennes. Je me vis forcé de subir le spectacle de ce supplice.
Un noir, quelque peu tenté par l'occasion, venait de dérober une poignée de figues sèches dans une caisse entr’ouverte, et trente coups de rotin devaient lui faire expier sa gourmandise. Le patient résigné vint se placer sous les verges du commandeur, espèce de chef sectionnaire, esclave comme ses subordonnés, mais investi de la confiance du maître. Un noir est toujours en costume de subir le rotin. A part un langouti, espèce de bandage qui lui couvre les parties sexuelles, il est complètement nu et n'a pour se défendre d'un soleil poignant que sa peau huileuse et cuivrée. Le coupable présenta donc au commandeur ses larges et musculeuses épaules, et l'exécuteur frappa. A chaque coup, c'était des contorsions horribles, et vers la fin surtout, quand le rotin frappa sur les chairs vives, le noir poussa des hurlements. J'étais indigné quand Verger m'entraîna:
«Allons, toi aussi ne vas-tu pas faire comme ce philanthrope de l'autre jour, qui a failli révolutionner la colonie? Mais c'est donc un parti pris? vous voulez être tous des Wilberforce; vous voulez tous faire des expériences sur notre peau à nous, pauvres colons, qui serons rôtis vifs, comme à Saint-Domingue, le jour où l'on pratiquera vos beaux projets! En quatre mots et deux axiomes, mon cher ami, voici notre affaire. Sans les noirs, point de colonies; sans le rotin, point de noirs. Il ne faut pas sortir de là.
- C'est ce que vous criez sur les toits au moins, et vous voulez qu'on vous croie sur parole. Ecoute; ce n'est ni toi ni moi qui résoudrons le problème. Je voudrais seulement que les peuples européens sentissent qu'il est ridicule de soutenir à grands frais des possessions qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Livrés à vous-mêmes, vous feriez vos codes noirs; mais, mon cher Verger, gare à la débâcle. Tu as cité Saint-Domingue; eh bien! regarde à qui elle est aujourd'hui. Vous invoquez pour vous le droit du plus fort; qui sait si demain on ne l'invoquera pas contre vous!
- Bah! on en court la chance mais qu'on ne nous gâte pas la partie avec vos lois faites à Londres ou à Paris, et qui nous vont comme un habit bleu sur le dos d'un Malgache. Ce diable de Colleville, par exemple, est l'homme des mulâtres; et les mulâtres, vois-tu, pour nous c'est pire que les noirs. Il y a du mulet dans cette espèce, neutre pour le bien, têtue pour le mal. Protégés par les Anglais, ils se sont britannisés, et nous les haïssons comme gens de couleur et comme partisans de nos maîtres. Entre eux et nous guerre à mort. Les chenapans sont cause encore que nous traitons nos nègres plus mal qu'auparavant. Pauvres nègres! leur condition est cent fois pire depuis qu'ils sont protégés par les Anglais. A Port-Louis, ce n'est rien; mais tu verras dans les habitations du S.O. C'est là que les planteurs sont durs
- S'ils argumentent seulement à coups de rotin, comme sur la place de la Douane, c'est déjà plus qu'il ne faut pour faire sortir de dessous terre des Christophe et des Toussaint.
- Impossible, mon très-cher, impossible! Sur les 100’000 anses qui peuplent l’île, il y a bien 80’000 esclaves; mais cette population se compose de castes infinies, qui ne parlent pas la même langue et n'ont pas les mêmes intérêts. Une pensée commune, la liberté, ne dominera jamais les haines de tribus à tribus, de peuple à peuple, qui séparent cette marqueterie d'hommes. Le Maure et le Yolof sympathiseront difficilement avec le Cafre, le Malgache et le Mozambique: un abîme sépare ces races africaines des races indiennes, du Malais, du Malabare, du Talinga, du Bengali, du Maratte, etc. Avant de se liguer pour l'extermination des blancs, il faut que ces divers esclaves s'entendent; et je te l'ai dit, c'est impossible. S'ils le faisaient, ils trouveraient encore à qui parler. Un prestige entoure le créole aux yeux des noirs; avec quelques milices on verrait la fin d'un soulèvement.
La force, toujours la force! Ne la faites pas tant valoir; tôt ou tard, elle reste au plus grand nombre. Ne vaudrait-il pas mieux, vous qui profitez des sueurs de ces hommes, chercher à vous en faire des instruments plus utiles, en les civilisant. Aussi le fait-on, noble philanthrope; c'est notre intérêt, et nul n'y manque. En quelques leçons, les noirs deviennent des ouvriers habiles.
Tu vas voir, aux chantiers, des charpentiers qui valent à leur maître sept et huit piastres par jour. Bruts, ils ont coûté trois cents piastres d'achat; ils rapportent le triple dans un an; leur industrie devient une plus-value qui augmente leur prix; et M. Monneron a eu tel esclave qu'il n'aurait pas donné pour quatre mille piastres. De telle sorte que, si ces malheureux pouvaient et voulaient se racheter, ils auraient quelque bénéfice a se couper le bras pour obtenir des conditions meilleures.
- On y a égard, diable! on n'est pas turc. Presque toujours, au bout de quelques années de travail, le noir industrieux est affranchi; on en fait autant pour de longs services, pour des actes de dévouement, pour de bonnes actions. Mais telle est chez ces hommes la force de l'habitude, que la plus grande partie d'entre eux n'accepte la liberté qu'à contrecœur, et souvent on en voit demander avec instance de rester auprès de leurs maîtres. Dans la maison du blanc, tout en effet est réglé pour eux, travail, nourriture, repos. Libres, ils auront le souci de chercher de la besogne, de pourvoir à leurs besoins, de choisir un toit pour reposer leurs têtes. Ils aiment mieux continuer à vivre comme ils ont vécu; et je sais plus de trente habitations dans la colonie, où les noirs sont plus heureux et mieux traités par leurs maîtres, que les paysans d'Europe par leurs propriétaires.
- Dieu me damne! Verger, ton esclavage est un âge d'or j'ai presque envie, parbleu! de troquer mon bâton de voyageur contre le langouti de tes nègres! As-tu quelque bonne place vacante de porteur de palanquins? Veux-tu me nommer grand-command eur de ta case? On dirait vraiment, à t'entendre, que tes esclaves sont plus heureux que toi! N'en as-tu jamais trouvé parmi eux qui aient senti le besoin de vivre libres, sans être secoués à chaque minute par la lesse du maître?
- Que trop, pardieu, que trop! Il y en a d'intraitables parmi ces gaillards-là. L'autre jour, chez un habitant de mes amis, trois Cafres ne se laissèrent-ils pas mourir de faim! Sur les achats des noirs bruts, pris sur la grève, on compte toujours un déchet de 20 % dans la première année. Tantôt c'est la nostalgie qui les emporte, tantôt le changement de climat, tantôt les premières épreuves du travail.
D'autres fois ils parviennent à rompre leur ban, et à fuir vers les montagnes. On les appelle alors nègres marrons; et plusieurs troupes de ces déserteurs errent constamment dans les mornes de Pile, où on les traque comme des bêtes fauves. L'incendie, le vol, le pillage, tout leur est bon pour se maintenir dans l'indépendance. Lorsqu'ils vont en maraude, ils s 'enduisent le corps d'huile de coco, et leur peau devient alors si glissante, qu'ils fuient sous les doigts et deviennent presque imprenables. La race la plus jalouse de liberté, celle qui regrette le plus la patrie, est la race des Malgaches. Toute punition corporelle les révolte; ils préfèrent chercher la mort dans les tentatives les plus hardies. On en a vu s'emparer d'un canot et s'aventurer ainsi en pleine mer. D'autres ont poussé la persévérance jusqu'à creuser dans la forêt une pirogue, faite d'un seul arbre; ils l'ont traînée à la côte, l'ont mise à flot, et se sont jetés dans ce morceau de bois, pour une traversée de cent lieues. Quand la pirogue ne pouvait les contenir tous, une partie suivait à la nage et alternait avec ceux qui s'étaient embarqués lès premiers.
- Et voilà les hommes que vous traitez comme des brutes, Verger! ce sont des héros. Ceux parmi vos nègres, que vous voyez dociles, résignés, je les appelle, moi, les plus lâches, les plus vils de leurs tribus. Ce que vous traitez de mauvais sujets, ce qui se résigne à souffrir la faim et la soif plutôt que la honte du rotin, ce qui meurt au lieu d'obéir, ce qui préfère une tempête de l'Océan à la servitude, voilà la partie noble, virile, courageuse des peuplades noires. Allez, vous êtes des égoïstes qui mesurez les vertus et les vices sur l'échelle de vos intérêts! Pour tout au monde, je ne voudrais vivre longtemps avec vous, me faire à vos préjugés de colons, qui sont une nécessité peut-être. Il y a là-dedans quelque chose de trop affligeant pour le cœur, de trop dégradant pour l'humanité. C'est toujours l'ilotisme appliqué au plus grand nombre, par les privilégiés de la peau, comme autrefois en Europe par les privilégiés de la naissance. C'est l'éternelle oppression des masses ignorant leurs forces, par des castes puissantes de leur union.
La thèse philanthropique nous avait conduits très-loin; nous avions vu tour à tour les chantiers, l'église, la jolie fontaine du port, et nous étions alors devant un café qui fait face à la salle de spectacle. «Entrons, me dit Verger; aussi bien, il est temps de mettre fin à une discussion interminable».
Là, nous trouvâmes une foule de jeunes créoles, fumant, jouant au billard; tous d'une grâce et d'une gaité parfaites, de manières aisées et nonchalantes, d'une mise où le plus grand luxe n'était que de la propreté. On rit beaucoup, on causa de la France, de Paris surtout, ce centre d'active impulsion, qui va rayonner si-loin. Il fallut que je racontasse au long tout ce qui occupait notre capitale à mon départ; que je parlasse des Italiens et de l'Opéra, de madame Malibran et de mademoiselle Taglioni. Ici on me questionnait sur la coupe des habits; là sur la Chambre des députés, et sur la grande péripétie politique qui avait eu lieu le 8 août précédent. Depuis deux mois en effet, on savait à l'Île-de-France l'avènement du ministère Polignac, et moi, coureur nomade et insoucieux, j'en étais réduit à demander des nouvelles au lieu d'en donner. Ce fut donc dans un café de Port-Louis que j'appris le coup de tête de Charles X et le premier incident du va-tout de la dynastie.
J'étais là depuis deux heures à peine, que déjà je comptais trente amis à l'île-de-France, trente hôtes si j'avais voulu. Il fallut presque que Verger se fâchât pour me défendre contre leurs pressantes invitations. L'un voulait, m’entraîner à dîner, l'autre au bal; celui-ci avait un palanquin à la porte pour me conduire à son habitation; celui-là une yole avec ses rameurs pour une fête en rade; c'était à en être confus. Enfin mon hôte prit un parti décisif; il m'enfonça mon chapeau sur la tête, me poussa par les deux épaules et me jeta hors du café.
La nuit arrivait, et avec elle Port-Louis prenait une autre physionomie. Les nègres travailleurs avaient cessé leur chant monotone; les uns, accroupis encercle à l'angle des rues, terminaient leur frugal repas de brèdes, de maïs ou de manioc; les autres se pressaient à la porte des vendeurs d'arack pour y boire leur petit verre sur le comptoir. L'arack est le rhum des nègres; on l'obtient aussi de la fermentation de la canne à sucre. Dans un coin du Champ-de-Mars, une bande d'esclaves s'était groupée en rond. Nous nous approchâmes.
- «Tiens, regarde, me dit Verger, c'est une Chéga une danse mozambique. Nos noirs du port vont s'en donner; c'est demain dimanche.» La fête commença. Elevé sur une espèce de tertre, un vieux Cafre, aux cheveux gris, aux yeux sanguinolents, plaça entre ses jambes une espèce de tambour, lamlam, sur lequel il frappait avec ses poignets. Près de lui, un second musicien mettait en jeu un singulier harmonica, composé d'un simple fil d'archal tendu sur un bâton, et eu tirait des sons aigres avec une baguette résistante. En même temps, cinq ou six voix entonnèrent un chant africain doux, traînant et mélancolique.
A l'appel de cet orchestre, un nègre et une négresse s'élancèrent demi-nus. Leurs premières passes furent sans caractère; ils s'approchaient l'un de l'autre, mollement, avec insouciance; puis s'éloignaient en pirouettant sur eux-mêmes. Mais peu à peu, comme si un magnétisme graduel eût agi sur leurs sens, ces visages ternes et mous devenaient expressifs et caractérisés. C'était d'abord la première phase d'une passion; la langueur dans les traits, le geste timide et insinuant, la pose prude encore et minaudière; puis, quand le charme avait agi, par degrés toute cette pudeur s'en allait; l'attitude devenait moins décente, les mouvements plus lascifs, les poses plus licencieuses. La musique suivait cette progression. Dans le dernier paroxysme, quand le couple danseur se rapprocha au point que les genoux claquèrent l'un contre l'autre, et que les haleines se confondirent, ce fut parmi cette foule d'esclaves une ivresse convulsive, des trépignements, des cris et des contorsions. La contagion des postures avait gagné les spectateurs: les saturnales des anciens étaient retrouvées.
La place n'était plus tenable: nous partîmes, et, traversant de nouveau la ville, nous la trouvâmes resplendissante de lumières dans ses rues marchandes. Des magasins de soieries et de joaillerie, des cafés, des boutiques de confiseurs, de liquoristes, déployaient leurs brillants étalages le long des rues qui avoisinent le port. C'était mieux que dans nos villes de province, et ce quartier n'eût pas déparé une capitale.
Le lendemain, pour la première fois, j'assistai à un repas servi avec tout le luxe créole. Madame Verger y avait mis un amour-propre de mulâtresse, et ce fut une profusion de vaisselle plate et de porcelaine de Chine, un pèle-mêle de vins exquis, depuis le madère jusqu'au champagne, un luxe de nègres et de négresses, attentifs à épargner aux convives jusqu'à la fatigue d'un geste. Tous ces esclaves, hommes et femmes, étaient de figure agréable; on eût dit que la maîtresse du logis les avait choisis un à un. Au-dessus de la table, dominait une espèce d'éventail fait de feuilles de latanier, et qui, ébranlé d'une manière constante et uniforme, maintenait de la fraîcheur dans l'air et chassait les insectes incommodes. Malgré soi, on se laissait aller à la séduction de cette vie somptueuse et sybarite. A travers les treillages, se tamisait une brise déjà tempérée par des bosquets d'acacias et de palmiers; l'eau, déposée dans des bardaques réfrigérantes, en sortait limpide et fraîche comme de la glace; et, autour d'une table chargée de fleurs et de mets, quelques convives, amis de Verger, et quelques ravissantes mulâtresses complétaient le gracieux ensemble du tableau.
Notre hôtesse avait voulu m'essayer sur la cuisine créole; et d'abord parut le plat obligé de brèdes, espèce de morelles accommodées avec du petit salé; puis le kary classique des colonies, que nos restaurateurs parisiens ont profané dans une sorte de juste-milieu culinaire. Le vrai kary, le riz au piment, a des abords rudes pour les expérimentateurs. S'il est consciencieusement fait, tout Européen qui en goûte doit se croire empoisonné. Il vous saisit à la gorge, vous brûle le palais, vous arrache l'épiderme; mais on s'y habitue ensuite, et l'usage d'un pareil tonique est efficace sous un ciel où la fibre, toujours molle et détendue, a besoin d'un réactif contre la transpiration. Ensuite vint le gros du festin, avec un luxe de service, un abus de sucreries, une prodigalité de dessert dont on ne peut se faire une idée. J'y goûtai les fruits succulents qui abondent à l'Île-de-France, la mangue, la banane; l’atte, l'avocat, l'ananas, mêlés aux plus belles variétés de notre Europe. Au champagne, on entonna le couplet, car on chante encore dans les colonies; et nous ne quittâmes la table que pour nous rendre au théâtre, où une loge nous attendait.
Construite en bois, la salle de Port-Louis est d'une ordonnance assez mesquine. La troupe de comédiens français qui l'exploite se partage entre l'Île-de-France et l'Île Bourbon. Au moment où je débarquai, cette salle était devenue une arène politique, où les colons se repaissaient d'allusions contre la nation anglaise. Toute la jeunesse créole s'y donnait rendez-vous, tantôt pour applaudir avec fureur les scènes où notre orgueil national était caressé, tantôt pour provoquer et insulter les officiers de la garnison. Ce soir-là, on donnait le Bourgmestre de Saardam, et toutes les fois que l'acteur articulait sa phrase familière, relativement à l'Angleterre, il en résultait un tapage à ébranler les voutes, des cris, des trépignements de pieds, des hourras, des sifflets, des menaces, des insultes de tout genre. Le rideau tomba sur ce vacarme, qui ne finit même pas avec la représentation.
J'étais destiné, dans ma courte station à Port-Louis, à passer d'une fête à l'autre. J'assistai d'abord à un banquet de maçons, puis à une réunion chantante, et enfin à un bal au palais du gouvernement, dont lady Colleville fit les honneurs avec une rare affabilité. De vastes salons fourmillaient d'élégantes danseuses, toutes en blanc, satin, mousseline, ou gaze, avec des fleurs ou des diamants dans les cheveux. Ces femmes avaient en général les traits réguliers et expressifs, la taille svelte et gracieuse, le port plein de nonchalance et de majesté. Des filles de douze à treize ans étaient aussi développées que nos Européennes à dix-huit. Une fois cette première jeunesse passée, l'âge ne glisse pas sur elles sans laisser de profondes traces. A vingt ans déjà leur teint a perdu ses couleurs; à trente ans, leur beauté n'est plus qu'un souvenir. Les jeunes gens ne sont pas à l'abri de cette vieillesse précoce. Soit qu'il faille en accuser le climat, soit que la cause en soit dans une adolescence débauchée, toujours est-il que le créole supporte difficilement une vie active et laborieuse.
Malgré mon désir de prolonger ma halte dans cette ville si française, si parisienne, il ne me restait que deux jours, deux jours que j'avais destinés à une tournée dans les habitations. Outre sa ville de Port-Louis, l'Île-de-France, dans sa circonférence de quarante-cinq lieues, compte onze autres quartiers, les Pamplemousses, la Poudre-d'Or, Flac, la rivière des Remparts, les Trois-îlots, le Grand-Port, la Savane, le quartier Militaire, Moka, les plaines Willems, les plaines Saint-Pierre. Ne pouvant tout voir, je m'attachai aux sites les plus curieux; et Verger, toute affaire cessante, voulut m'accompagner.
Le lendemain, au point du jour, nous étions en route pour les Pamplemousses, moi sur un âne vigoureux, lui dans son palanquin. Les Pamplemousses! Que de poésie dans ce mot pour un Européen! J'y allai plein de mes jeunes souvenirs littéraires, j'y allai comme un croyant à la Mecque, espérant retrouver là tout mon Bernardin de Saint-Pierre, mon Paul et ma Virginie, sur qui j'avais tant pleuré; reconnaître les torrents qu'ils avaient franchis, embrasser leur bon vieux nègre, causer d'eux avec le pasteur. Verger riait: il prévoyait le dénouement. Quand les noirs s'arrêtèrent: Eh bien! lui dis-je, qu'as-tu donc? Nous y sommes, répliquait-il, je descends. Nous y sommes!»
A ce mot, toute la fantasmagorie se dissipa. Quelques mauvaises cases à nègres, un sol maigre, trois ou quatre bouquets de cocotiers, et au fond une mâsure, voilà l'église des Pamplemousses, ajouta Verger, en me la montrant (PL. VII-- 2). «O mécompte! ceci l'église des Pamplemousses, ceci le temple, si romanesque, si beau, si recueilli de Bernardin? Et où est l'allée de bambous qui y conduit? où sont les tertres de verdure? et ses ombrages? et ses eaux? Tu veux me mystifier, Verger!» J 'étais presque en colère.
«Parole d'honneur, c'est cela.» Je voulais rebrousser chemin; mais il me calma, et, m'entraînant par un sentier, il me conduisit au jardin du Gouvernement. J'y pris ma revanche: dans ce local ont été recueillis à grands frais les arbres les plus rares de l'Inde et de toutes les contrées intertropicales. De longues allées de palmiers le coupent dans tous les sens, des canaux d'eau courante le vivifient: ses clôtures sont composées de bambous qui se balancent à la brise, de raphias chargés de régimes, de sappans et d'autres arbres exotiques. C'est dans ce jardin que M. Poivre, aussi célèbre administrateur que bon naturaliste, organisa des pépinières de poivriers, de girofliers, de muscadiers. Ce fut là que plus tard M. Céré cultiva un nombre prodigieux d'arbres et d'arbustes arrachés les uns aux plages ardentes de l'Afrique, les autres aux rivages humides de Madagascar. Ceux-ci sont venus de la Chine ou du Pérou, ceux-là des bords de l'Indus et du Gange; plusieurs vécurent dans les riches vallées de Cachemire, d'autres aux sommités des Gattes, ou sur le littoral du golfe Persique. L'Asie, Java, Sumatra, Tahiti, les Canaries , les Açores, l'Amérique, l'Arabie, tout a fourni des représentants à ce congrès de végétaux. L'une des plus utiles conquêtes en ce genre fut la naturalisation de l'arbre à pain que l'on doit aussi à M. Céré. Dans cette même enceinte croissent le jaquier aux fruits oblongs et arrondis dont le poids va jusqu'à cent livres; l'altier, l'ananas, le franchipanier, le manguier, le goyavier, le papayer, le bananier, le tamarinier, le mangoustan, le sappan; et, parmi les plantes et arbustes, le veloutier, la cassie, la poincillade, le mongris, le foulsapate, le benjoin , le bois de cannelle, le nagas et le bois de sandal.
Ma seconde journée, mieux remplie encore et plus fatigante, me conduisit aux plaines de Moka et de Wilhems par la rampe du Pouce. Au lever du soleil nous traversions la pelouse du Champ- de-Mars, et nous saluions au-delà d'un petit bois un monument élevé à la mémoire du genéral Malartic, ancien gouverneur de l'île. Vue de sa base, la montagne du Pouce permet de détailler les divers mornes qui la composent et au centre desquels s'élève le piton d'où son nom lui est venu.
Nous commençâmes alors à gravir un sentier creusé dans le roc vif que l'on doit à l'ingénieur Phéline; nous reposant de coude en coude pour admirer la scène imposante qui se déroulait devant nous; les rues de Port-Louis à nos pieds, à droite les Pamplemousses, à gauche la grande rivière, puis ces mille et un détails qui échappent à l'analyse; les mâts qui sortaient de l'eau comme un faisceau de piques; les hauts palmiers, les calebassiers, qui s'arrondissaient en parasols, et près de nous des ruisseaux qui semblaient pressés d'aller se mêler à ce magnifique paysage (PL. VII -1).
Plus haut, commence un autre genre de beautés: tout le système géographique de Pile, tous ses mouvements de terrain; la montagne Longue qui est l'arête la plus haute de ce système au N. N. E.; le morne de la Découverte, le morne des Deux-Mamelles, Peter-Bot, le Piton, la montagne du Rempart, celle du Corps-de-Garde et une foule d'autres mamelons qui semblent s'adosser les uns aux autres, offraient matière à de nombreux relèvements. Au-dessus de nos têtes et autour de nous poussaient des forêts d'arbres entrelacés de lianes sarmenteuses qui produisent les effets les plus bizarres. Tantôt élancées de la base du tronc, elles tournent en spirale et figurent d'énormes serpents; tantôt descendues des branches, elles vont à terre comme des cordages, y prennent racine, puis remontent en siphons et s'arrondissent en arcs de verdure. A ces hauteurs peu battues abonde l'espèce de singes que l'on nomme les singes verts, animaux à la queue traînante, à la grosse tète chevelue. Les uns, assis gravement sur l'aiguille d'un roc, nous regardaient passer à distance; les autres, se balançant aux tiges des lianes, y exécutaient les plus étonnantes évolutions. Cependant ils ne regardaient pas sans quelque défiance un fusil à deux coups dont je m'étais armé. A l'aspect de cette bande d'animaux, nos nègres se mirent à échanger avec eux des grimaces horribles. Celui qui était près de moi me tira par le pan de ma veste. «Mosié, mosié, dit-il, çà petit di monde la n'a pas voulé palé pour n' a pas travail. - Ce petit monde-là ne veut pas parler pour ne pas être obligé de travailler.
Les planteurs pour qui les singes sont un fléau leur font une guerre continuelle; mais ces maraudeurs s'en vengent en dévastant des champs entiers de maïs et de bananes. Quand ils sont surpris, ils ne lâchent pas leur proie: ils fuient en l'emportant sous chaque bras, et les femelles chargent en outre sur leur dos leurs petits qu'elles n'abandonnent jamais. Dans ces jours d'expédition aventureuse, les singes ne procèdent jamais isolément; ils vont par bandes et placent des vedettes sur les hauteurs. Ces vedettes épient au loin et signalent le danger par un cri aigu. A cette alerte, toute la troupe se reforme, s'enfuit au cœur du bois et s'abrite dans des creux impénétrables. Quelquefois le champ de bataille garde quelque victime, et le plomb des planteurs atteint un individu de la bande; mais la vie est si dure chez ces animaux, qu'il est rare de les voir tomber sur place. Blessés, ils se blottissent dans un taillis, d'où leurs camarades viennent les retirer quand le chasseur est loin.
Comme je n'étais pas d'humeur guerroyant, j'aurais passé sans mot dire à côté de cette troupe de singes, quand l'un d'eux s'avisa de commencer les hostilités en nous décochant un fragment de roche, et les autres par imitation firent pleuvoir sur nous une grêle de pierres. Fort de mon droit de légitime défense, j'ajustai alors le plus proche de nos agresseurs, et quelques grains de plomb l'atteignirent sans doute, car il me riposta par la plus épouvantable grimace, se frottant convulsivement les cuisses, montrant ses dents à nu jusqu'à la racine et les faisant claquer les unes contre les autres. A la détonation, les singes groupés sur les arbres voisins se dressèrent sur leurs deux pieds, croisèrent leurs bras sur la poitrine comme pour se tâter; puis, après quelques secondes d'immobilité, prirent leur élan et sautèrent de branche en branche jusqu'à ce qu'ils fussent tout-à-fait hors de vue.
Bientôt, par le travers d'une clairière qui contournait la montagne, nous aperçûmes dans le lointain les plaines de Wilhems, au bout desquelles, comme un filet d'argent, serpentait la rivière de Moka. Quelques heures de route nous conduisirent à ce magnifique plateau couvert de riches plantations et de fabriques élégantes. Le bambou est très abondant dans ces parages, et les colons de 1'Î1e-de-France varient à l'infini l'emploi de ce roseau gigantesque qui monte jusqu'à une hauteur de 60 pieds. De la même souche s'élance une multitude de jets; sa tige est creuse et luisante à l'extérieur, et sa force est telle que deux morceaux de bambou de 10 pieds de longueur sur 3 pouces de diamètre pourraient supporter, dit-on, un poids de 1,500 livres.
Le bassin de Moka est le quartier de l'île le mieux abrité contre la violence des vents. Aussi la végétation y est-elle plus belle et la récolte plus sûre que partout ailleurs. C'est dans ce rayon que se trouve la maison de campagne du gouverneur. On y arrive par un pittoresque chemin que traverse la rivière du Mesnil, sur laquelle un pont a été récemment jeté (PL. VII — 3).
Non loin de là se trouve la grande cascade du Réduit, d'où l'eau se précipite en vaste nappe d'argent d'une hauteur perpendiculaire de 120 pieds. Quand on regarde cette masse écumeuse à travers les rayons solaires, elle revêt toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Encaissée entre deux monts touffus, la cascade tombe dans un profond ravin où le torrent se reforme et reprend son cours. Le paysage qui entoure cette chute d'eau est d'un effet merveilleux. Au milieu des fougères, des nopals et de vigoureux aloès, grandissent des arbres gigantesques, le bois de natte, le vaquois, le tackamaka et le bois de fer. D'espace en espace un barrage de rochers arrête la rivière; stagnante alors elle forme de larges bassins, jusqu'à ce que, débordant le niveau de l'obstacle, elle coule de nouveau vers la grande rivière.
La campagne du gouverneur, le Réduit, se trouve placée dans une presqu'île de rocs volcaniques, sur un plateau étroit et élevé, et au confluent de deux torrents qui roulent plutôt qu'ils ne descendent de la montagne. L'aspect sauvage du lieu lui a fait donner le nom de Bout du monde. Sur cette base de lave quelques pieds de terre rougeâtre suffisent pour nourrir la plus belle végétation. La maison de campagne est plus longue que large, à un seul étage, et bâtie en bois comme toutes celles de la colonie. Au rez-de-chaussée sont des salles de réception, et au-dessus les appartements des visiteurs que le général Colleville traite chez lui avec une hospitalité toute coloniale. L'ameublement n'est pas somptueux, mais il est commode contre les chaleurs: tiré presque entièrement de la Chine, le bambou en fait tous les frais. Les meubles de l'Europe résisteraient difficilement au vent sec qui règne de mai en septembre, et encore moins à l'humidité chaude, inséparable de la saison des pluies. Quand lady Colleville sut que nous étions venus parcourir le Réduit, elle nous fit prier à dîner; mais on nous attendait chez un habitant du voisinage, et force nous fut de remercier.
Au retour, nous passâmes à travers champs par des plantations de canne, parsemées de blocs énormes. Tout le sol de l'île présente les mêmes accidents, et les planteurs assurent qu'ils n'auraient aucun avantage à le déblayer de ces masses basaltiques qui servent à contenir le terrain et à rompre la force des ouragans. Chemin faisant, nous tuâmes quelques oiseaux; le calfat, espèce de bruant, dont les parties supérieures sont d'un cendré bleuâtre, le dessus de la tête et la gorge noirs, la poitrine et le ventre lie de vin, le bec et les pieds roses; le cardinal (Loxia madagascariensis) dont la tête et le corps sont couleur de feu; l'un et l'autre oiseaux destructeurs comme nos moineaux, et surnommés par les nègres mangeurs de riz; puis des tourterelles cendrées, plus petites que celles d'Europe, et d'une chair délicate; des martins, des perdrix, des pintades et des perruches. Nous vîmes aussi quelques lièvres à la fourrure fauve et aux longues oreilles, et des tandrecs, espèce de hérisson dont les nègres sont friands. Verger m'avait fait espérer que nous rencontrerions des cerfs; mais, depuis quelques années, cette espèce, sacrifiée aux divertissements des colons, est devenue fort rare.
Ainsi, tantôt à pied, tantôt sur des montures, nous arrivâmes devant l'habitation de M. L***, riche planteur qui faisait valoir par lui-même sa propriété des plaines de Wilhems. Une belle étendue de terrain, trois cents nègres, et une des meilleures sucreries de l'île, tel était le capital de M. L***, arrivé à Port-Louis depuis dix années seulement. Il nous reçut à bras ouverts, et fit disposer pour nous ses deux plus jolis bancalangs (pavillons). A peine rafraîchis, il fallut, nous prêtant à sa petite vanité de propriétaire, visiter tout avec lui, d'abord son logement de maître, le camp des nègres, où ils sont classés sous la verge d'un commandeur; ensuite les ateliers de travail, les magasins où s'entassent les récoltes, les cuisines, l'hôpital et la lingerie. La sucrerie, alors en activité de fabrication, nous intéressa longtemps. Des nègres revenaient des champs, chargés d'énormes brassées de cannes, et les déposaient près d'une meule qu'un cours d'eau mettait en mouvement. Le suc exprimé coulait au sein de réservoirs, d'où on le transvasait dans de grandes chaudières, chauffées à grand feu, pour la cuisson. Au bout d'un temps calculé, la clairée se coulait dans de grandes formes, destinées à la cristallisation du sucre, et, quand la matière se trouvait coagulée, on la jetait sur une terrasse bien plane, où l'action de l'air et du soleil la blanchissait et lui donnait du grain. Devant la fabrique s'empilaient les bagasses, résidu des cannes qui avaient passé sous la meule. Elles devaient servir à la fabrication du tafia et de l'arack (PL. V II — 4 ).
M. L*** nous expliqua tous ses procédés d'épuration et de cuisson avec une complaisance infinie; il ne semblait pas jaloux de faire un secret de sa recette, qui pourtant lui avait valu d'être cité parmi les meilleurs fabricateurs de l 'île. De la sucrerie, il nous fit passer dans son petit verger de cafiers, qui n'était pour lui qu'un objet de peu de rapport; dans ses champs de maïs et de manioc, et dans ses plants de girofliers et de muscadiers. Pour rentrer à l'habitation, où nous rappelait le repas du soir, il fallut traverser de nouveau le camp des nègres, et nous les vîmes tous accroupis sur le seuil de leurs cases, dévorant leurs rations de manioc. Ces esclaves étaient robustes et dispos; les femmes, à demi-nues comme les hommes, avaient des formes plus vigoureuses qu'élégantes. Toute cette population logeait, couchait là, presque pêle-mêle. Il y avait bien, entre noirs, des mariages pour la forme, mais dans la nuit il se passait des choses étranges, tantôt en trocs volontaires, tantôt en infidélités sans nombre, d'où résultaient des scènes plutôt comiques que sérieuses. Les races noires, avec leur sang brûlé par le soleil, sont en général ardentes et passionnées. Mais, hommes et femmes, l'abus du plaisir les énerve de bonne heure et les destine à une caducité précoce. Il est rare qu'un nègre ou une négresse d'habitation vive au-delà de cinquante ans.
Tout me plaisait à Île-de-France, climat, mœurs, habitants, et je n'y avais jusqu'alors trouvé que deux ennemis, les kakerlats et les moustiques. Le kakerlat ou kankrelat (Blatta americana) est un insecte vorace et fétide qui multiplie à l'infini, et qui, sans être dangereux, ronge et écorne tout, se glisse dans les balles de jonc, pullule dans les magasins et dans les boiseries des maisons de l'Île-de-France. Rien n'échappe à sa voracité, meubles, linges, habits, provisions; c'est un véritable fléau. Quant aux moustiques, moins hideux et moins dégoûtants, ils sont plus incommodes à cause de leurs cuisantes piqûres Les nouveaux débarqués sont l'objet des préférences de ces moucherons; ils bourdonnent autour d'eux, les harcèlent, les piquent, et il en résulte souvent des plaies à la figure et aux mains. Leur poursuite est si incessante et si acharnée, que la nuit tout sommeil serait impossible, si de vastes rideaux de mousseline n'entouraient pas les lits; encore a-t-on de la peine à se faire à un bourdonnement sourd qui gronde comme une menace continuelle aux oreilles de l'Européen. Les créoles sont moins sensibles aux attaques des moustiques.
«Ne t'inquiète de rien, m'avait dit à mon arrivée Verger, à qui j 'avais communiqué mon itinéraire. Tu veux aller à Madagascar par Bourbon; c'est bien: dans quelques jours je te charge à bord comme une balle de sucre; ne t'inquiète de rien; c'est mon affaire». Et depuis, je n'avais plus soufflé mot. Cependant, à notre retour de l'habitation de M. L***, je rompis le silence. «Viens avec moi, me dit mon hôte» et il me conduisit au café. Un jeune homme s'y trouvait, d'agréable et noble figure, portant dans ses traits une expression indéfinissable d'énergie et de douceur. Son teint était pâle, un peu halé seulement; ses cheveux noirs et lisses, ses yeux bleus. Je ne sais, mais cette physionomie, au premier abord, m'inspira plus le répugnance que de sympathie. Verger l'accosta.
«Capitaine George, lui dit-il, voici votre passager pour Tamatave. - Ah! ah! répliqua le jeune homme en attachant sur moi son regard fixe; eh bien! demain matin, à quatre heures, le Soleil dérape. — Nous serons prêts, capitaine.» Et, après cette courte entrevue, Verger m'entraina. «Viens, me dit-il, nous n'avons pas de temps à perdre; tes emplettes à faire, tes bagages à mettre en ordre d'ici à demain. Viens. - Verger, quel est donc ce capitaine George? - Un excellent marin, un fameux caboteur, va» et il sourit de manière à m'intriguer davantage encore. «Et quel commerce fait-il, ce fameux caboteur? - Ah! quel commerce? Pardieu! tous les commerces: commerce de bêtes à laine, commerce de bêtes à cornes. - Verger, Verger, tu as l'air bien goguenard! - Et non mon cher, il va à Madagascar pour y acheter des bœufs et du bétail qu'il revend ici. On y gagne, et je suis intéressé dans son affaire. Un associé, par Dieu! je ne pouvais te mettre en meilleures mains.» Je me tus, mais tout cela me semblait louche. La figure toute fantastique du capitaine George cadrait mal avec un chargement de bœufs. Je suivis Verger machinalement.
Cette fois il me fit passer en revue les vastes magasins de l'Entrepôt, où s'empilaient les cargaisons de l'Europe et de l'Inde. On y voyait des barriques de vin par trente et quarante mille; des pyramides de soieries, des montagnes d'indigo, de thé, de nankin. Ici on roulait des tonneaux; là on pesait des caisses; ailleurs on réglait des factures soit avec des piastres fortes, soit avec le papier-monnaie qui a cours dans la colonie.
«Voilà un commerce florissant, dis - je à Verger. - Moins qu'on le croirait, mon cher. Il y a des haillons sous ces paillettes d'or. Port-Louis est exploité, vois-tu, par une race de brocanteurs qu'on a surnommés banians, dépisteurs de petites affaires, fraudeurs de marchandises, détrousseurs des nouveaux débarqués qui ne savent pas se défendre. A l'arrivée d'un navire la grande comédie se joue. De ce qu'il porte, nul ne veut; tous demandent à grands cris ce qu'il ne porte pas. En fait de commerce, mon ami, il n'y a ici que du tripotage. Dans les premières années de la paix, l'Île-de-France fut l'el-Dorado des chercheurs de fortune; on y afflua des quatre points cardinaux; on y vint avec des pacotilles de toutes les sortes; pacotilles de marchandises et pacotilles d'hommes.
Dans les premières années, comme il y avait pénurie de tout, les chances furent belles; mais peu à peu on regorgea de monde et de denrées. I1 y eut plus de spéculateurs que d'affaires, et la réaction arriva. Le sucre était, de tous les produits de l'île, le plus demandé et le plus lucratif; on rasa les cafiers pour planter des cannes. Alors et peu à peu le sucre baissa jusqu'à ne pas produire les frais de manutention, et il fallut se retourner vers d'autres cultures. A Port-Louis, un autre vertige s'emparait des esprits. Avec les premiers bénéfices, était venu le goût du luxe; au lieu des anciennes habitations simples, mais commodes, on bâtit des palais; au lieu de modestes palanquins, on voulut des voitures et des chevaux de luxe. Les bals, les soirées, les thés somptueux prirent le dessus sur les habitudes bourgeoises des créoles. On faisait assaut de fêtes et de festins; car l'usage était alors de mesurer le crédit et la fortune d'un homme sur le train de sa maison. Que résulta-t-il de tant de folies? des faillites, des pertes irréparables pour les négociants honnêtes, des prétextes de bilan pour les fripons.
Depuis cette débâcle, la colonie a eu de la peine à relever son crédit au dehors. Les armateurs étrangers y ont été victimes de toutes les façons; par la baisse des prix, par les banqueroutes, par l'exagération des denrées et de la main - d'œuvre. Un séjour de trois mois à Port-Louis pour un navire, c'est une ruine. Il n'y a pas de bénéfice d'armement qui y résiste, pas de prix de nolis qui le compense. Ce qui est pir encore, c'est que notre commerce n'a pas de caractère précis; il est français par les sympathies et les souvenirs; anglais par la force et par les convenances. Nos créoles demandent des articles parisiens, et l'exagération des tarifs nous empêche de les fournir. Il faut tromper, maquignonner ou se ruiner. Pour des négociants le choix n'est pas douteux.
«Quelque jour pourtant nos affaires reprendront une allure plus déterminée: la situation de 1'Île-de-France, son admirable port, son sol fertile, l'emporteront sur les sottises des hommes. La nature a tout fait pour nous il s'agit seulement de ne pas gaspiller ses œuvres. Ici peuvent aboutir les jonques chinoises, les bateaux pontés de Manille, les skips de la compagnie des Indes, les caïques de l'Arabie, qui viendraient échanger les denrées asiatiques contre les chargements européens. Le riz, le nankin, le thé, le sucre, le coton, le poivre, le cacao, le café, le girofle, l'indigo suffiraient aux plus riches retours des produits manufacturiers et territoriaux de l'Europe. Qu'on fasse de 1'Î1e-de-France un port franc, un bazar neutre, et l'équilibre est rétabli, et l'âge d'or commercial naîtra sur un petit point de l'Océan-Indien.»
J'avais laissé parler Verger; et peu à peu cet homme, se sentant sur son terrain, s'était échauffé, s'était grandi jusqu'à l'enthousiasme. Rentré dans mon pavillon, je mis en note cet entretien. Pauvre Verger! de longtemps encore, il ne verra réaliser son utopie de port franc! C'est trop beau pour que la diplomatie s'y prête. Le soir, il fallut dire adieu à cet excellent ami, qui encombra mon portefeuille de lettres de recommandation, embrasser mon aimable hôtesse, qui avait presque les larmes aux yeux, et employer la nuit à quelques apprêts de voyage. A trois heures du matin, j'étais à bord.
Le plus profond silence y régnait. Un mousse et un matelot hissèrent mes malles, et me firent descendre dans la chambre, où je m'endormis sur un canapé de bambou, il était neuf heures quand je me réveillai, et, au frémissement du navire, je reconnus que nous étions à la voile.
Des armes de toute espèce garnissaient la petite chambre où je me trouvais alors; cet appareil, un peu martial pour un transport de bœufs, réveilla toutes mes défiances. Monté sur le pont, elles redoublèrent: mon caboteur était une lette svelte et haut mâtée, chargée de toile, et filant sur l'eau comme un corsaire: quarante gaillards, à mine rébarbative, encombraient son plancher, et à cheval sur le couronnement, le capitaine George, le cigare à la bouche et le chapeau de paille rabattu sur les yeux, avait l'air d'épier le moment de se mettre en colère. «Diable de Verger!» me disais-je, quand le jeune homme vint vers moi, et avec le plus gracieux sourire: «Monsieur, vous êtes chez vous ici: commandez, les pilotins, les mousses, le cuisinier, tout est à vos ordres. Excusez-moi seulement si je vous laisse seul; les soins de la manœuvre... C'était une excuse: le navire était orienté; la brise était faite; il n 'y avait plus qu'à laisser courir.
Mais je compris que cet homme craignait mes questions, et je me résignai." Diantre: ajoutai-je pour me rassurer, Verger ne m'aurait pas envoyé dans un coupe-gorge! Pendant ces petits incidents, nous gagnions du chemin -l'Île-de-France s'abaissait derrière nous, et les hauts volcans de Bourbon grandissaient à vue d'œil. A sept heures du soir, nous laissions tomber l'ancre dans la rade de Saint-Denis. Tout le long de la côte de Sainte-Suzanne, nous avions vu se dérouler devant nous des bosquets de girofliers, des bois de cafiers, des champs de cannes à sucre, et, sur la plage, nous pouvions même compter les noirs qui regagnaient leurs cases après le travail du jour.
CHAPITRE X.
ILE BOURBON.
Vu de la rade, Saint-Denis se présente sur un amphithéâtre de rocs, flanqué à sa droite de la côte qui pend vers Sainte-Suzanne, et à sa gauche d'une haute et longue muraille basaltitique dont le pied baigne dans la mer et qui finit brusquement devant le golfe de Saint-Paul. Les maisons de Saint-Denis, disséminées sur un plateau, blanchissent au milieu de bouquets de cocotiers, et plus loin une vaste anfractuosité dessine le cours du ravin que l'on nomme la rivière de Saint-Denis. Un lit de cailloux ou galets signale l'embouchure de cette rivière (PL. VIII - 1).
Le capitaine George me donna trois jours pour voir l'île, trois jours qui, sans doute, devaient aussi profiter à ses impénétrables affaires. Le lendemain matin une pirogue m'attendait avec deux noirs: je m'embarquai, et, quand j'approchai de la grève, à la vue de cette mer qui se brisait sur les galets, de cette houle courte et brusque, je ne savais comment je toucherais terre sans me mouiller. Je regardai avec surprise une espèce de débarcadère au-dessous duquel les chaloupes venaient se placer. Là, ballottées par la vague, elles confiaient leurs marchandises et leurs passagers au jeu d'une grue qui les hissait sur un pont volant bâti sur pilotis, et aventuré à une vingtaine de toises dans la mer (PL. VIII — 2).
A plusieurs reprises, on a bien essayé d'améliorer la rade ouverte de Saint-Denis au moyen d 'un môle. Le gouverneur Labourdonnais ordonna le premier de grands travaux que ruinèrent les premiers rade-marées; et, tout récemment encore, une jetée avait été construite, forte en apparence et encaissant une crique artificielle. Mais l'œuvre de notre siècle n'a pas tenu plus longtemps que celle du siècle dernier. Habituée à tourner sans obstacle autour des...
 |
 |
 |
 |
 |
 |
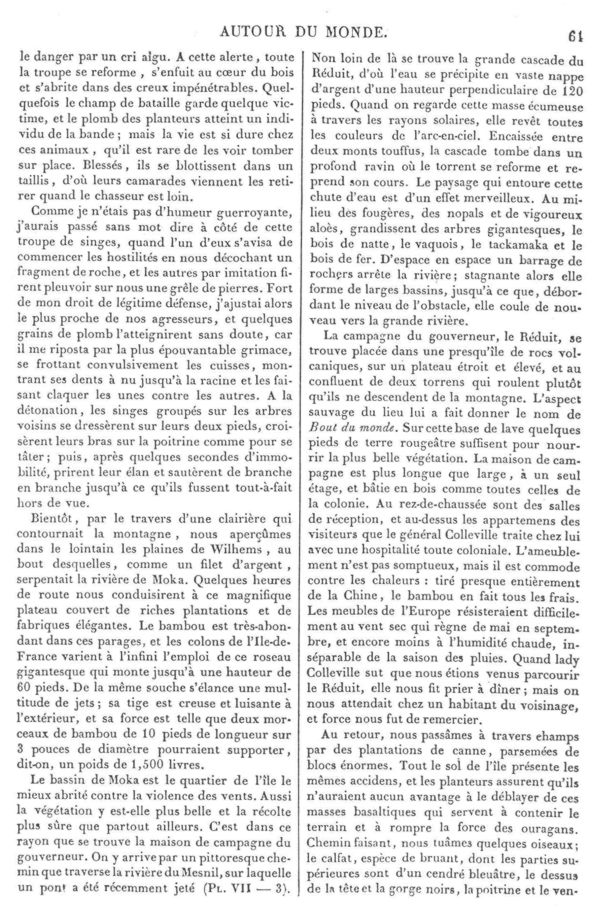 |
 |
 |
![]()
