| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
|
«Toxic Island» d'Ernest Pépin
TOXIC ISLAND, Ernest Pépin • Éd. Desnel • Avril 2010 • |
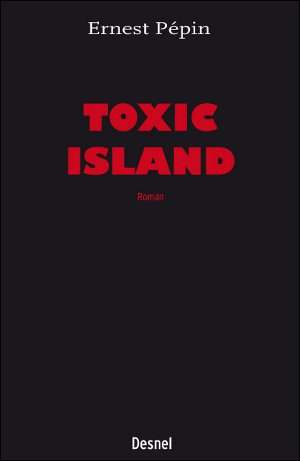 |
Nos contes créoles d’antan ont disparu depuis que l’on décède à l’hôpital et qu’il n’est plus possible d’organiser de veillées mortuaires dignes de ce nom. Les ont remplacés ce que les sociologues appellent des «légendes urbaines», récits tout aussi anonymes (quoique probablement non dépourvus d’auteur) qui circulent de bouche en bouche à la vitesse d’une mèche, repris qu’ils sont par les médias modernes et l’Internet. L’une de ces légendes évoque, dans la ville du Moule, en Guadeloupe, une magnifique créature féminine rencontrée, dans une boite de nuit, par un fringant jeune homme lequel des nuits durant fut son cavalier le plus assidu. Evidemment, il tomba amoureux de celle-ci. Jusqu’au jour où elle ne mit plus les pieds dans l’établissement. Il la rechercha à travers toute la commune pour finir par trouver la maison de sa mère qui lui apprit que sa fille était décédée depuis…cinq ans.
Avec son dernier roman, «Toxic Island», Ernest Pépin nous donne une belle leçon d’écriture de la modernité. N’a-t-on pas, en effet, sans cesse critiqué les auteurs de la Créolité au motif qu’ils seraient braqués vers le passé (univers de l’Habitation, Temps Robert ou Sorin etc.)? Pépin réussit un véritable bouturage de la néo-oralité créole (les légendes urbaines) avec l’écriture, ce à quoi échouent tous ceux qui s’imaginent qu’il suffit de parler du chômage, du sida ou de la drogue pour faire de la littérature antillaise moderne. Le romancier guadeloupéen démontre que si aucun lien n’est établi entre ces thèmes et l’oralité (la parole populaire en fait), on fait du roman français tropicalisé. Car un roman n’est pas une description ou une analyse sociologique et Pépin ne raconte pas l’épisode du Moule. Il le prend comme point de départ et construit une fiction qui lui est propre.
Le héros de «Toxic Island», Ringo de son surnom, est un jeune dealer d’herbe qui passe très vite à la cocaïne. Il vit ou plutôt survit de mille combines dans les quartiers populaires de l’En-Ville, entre «les ateliers nocturnes d’une armée de «travailleuses», parmi des allées et venues d’hommes en rut, parmi des flambées d’alcool, parmi l’étalage des boules de fesses et les effluves de sueurs coupables, parmi des folies effilées et des détresses sans nom». Ses amis ont pour nom Jo, le fou, Saucisson, un obsédé sexuel, Pilibo, bourré de crack, l’ex-belle Désirée, aux cuisses flapies et toute une cohorte de cabossés, déjantés, exclus de la société de consommation qui détruit à petit feu l’île-papillon. Il faut lire lentement et à mi-voix cette évocation hallucinante de la mal vie pour bien entrer dans les phrases serpentines de l’auteur qui, poète avant tout, sait nous étonner ou nous émouvoir au détour d’une virgule. Elle surpasse tous les constats d’échec sociologiques, toutes les grandes analyses politico-économiques.
Mais un miracle se produit au mitan de cet enfer tropical. Une rencontre incroyable. Dans la boite de nuit qu’il hante soir après soir, comme des centaines de comparses, question d’oublier son existence une miette de temps, il rencontre «une femme différente. Ses yeux presque dorés, brillaient étrangement sous ses paupières veloutées. Un chignon soigné soulignait la finesse de ses traits. Elle me faisait penser à Néfertiti l’Egyptienne. Et lorsque mon corps, délicatement, se posa sur le sien, une vague de chaleur m’étourdit là même.». Ringo en tombe amoureux fou. Sauf que Gina, c’est son prénom, lui déclare qu’elle est «une femme d’avant» et qu’elle a traversé le temps! Et de ce jour, elle multipliera apparitions et disparitions au grand désarroi de Ringo qui aura beau interroger ses amies, les femmes de mauvaise vie du Carénage, ne parviendra pas à percer son mystère. Un jour, ils finiront par faire l’amour et il découvrira un tatouage sur son épaule: «un fromager dont les branches se terminaient par des gouttes de lumière». Le fromager, arbre aux esprits! Man Sonson,la doyenne des «manawa», le mettra aussitôt en garde: «Garçon, tu es tombé dans quelque chose qui va te broyer. L’amour est une belle chose mais la passion mange la cervelle. C’est le Diable en personne! Cette femme-là n’est pas n’importe qui! Elle habite plusieurs mondes et le tout est de savoir dans lequel elle veut t’emmener.»
Ernest Pépin est, on le sait, de tous les auteurs antillais le poète et le romancier de l’amour pur, de l’amour absolu, au contraire de ses confrères et consoeurs qui préfèrent l’érotisme solaire tel René Depestre. L’auteur guadeloupéen semble placer la femme antillaise sur une sorte de piédestal inaccessible à côté duquel s’agenouillent timidement des créatures masculines au cœur ravagé, ruinant ainsi le concept stupide de «littérature féminine». Pépin est plus féministe que Schwarz-Bart, Condé et Pineau réunis, avec un talent littéraire égal, sinon supérieur. Mais ne pêche-t-il pas par idéalisme? C’est la question que l’on est en droit de se poser une nouvelle fois avec «Toxic Island».
Gina est donc une sorte de réincarnation de diverses figures féminines héroïques de la Guadeloupe depuis le 18è siècle. On peut donc y voir une métaphore du destin de son île ou plutôt des cheminements parfois tortueux que celui-ci a emprunté avant d’arriver au désastre actuel. Car la mystérieuse femme abhorre ce présent fallacieux fait de grosses villas, de cylindrées de luxe, de vie sexuelle débridée, de «zeb» et de cocaïne à tout. Nous n’allons pas déflorer la suite de l’histoire afin de permettre au lecteur de le découvrir par lui-même, l’écriture d’Ernest Pépin étant toujours un vrai régal.
![]()
