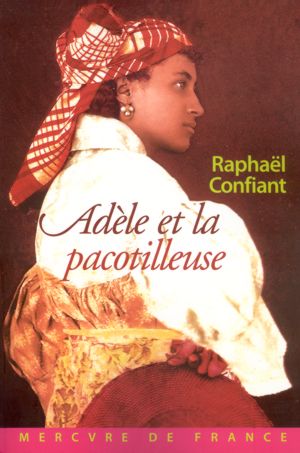| Adèle et la pacotilleuse Raphaël Confiant |
||||||||||
|
||||||||||
PrésentationAdèle, fille cadette de Victor Hugo, s'est enfuie en Amérique à la recherche de son amant, l'officier anglais Albert Pinson. D'Halifax, au Canada, à La Barbade, dans l'archipel des Antilles, Adèle poursuit un homme qui n'existe peut-être pas... Son esprit est dérangé et elle erre sur les quais de Bridgetown, capitale de la Barbade, lorsqu'elle est recueillie par Céline Alvarez Bàà, sauvée in extremis d'une déchéance absolue. Céline, solide négresse, est une pacotilleuse qui parcourt les îles et la terre ferme, de Saint-Domingue à Carthagène des Indes, de Cayenne à La Havane, munie de lourds paniers caraïbes où s'entassent colifichets, miroirs, Bibles, remèdes, tissus chatoyants et farine de manioc. Se prenant d'affection pour Adèle, elle décide de l'amener à Saint-Pierre de la Martinique, le "Petit Paris du Nouveau Monde", puis de la raccompagner en France chez son illustre père... Comment cette négresse habituée aux coups de vents de la vie, descendante de conquistadors, de flibustiers et d'esclaves africains sera-t-elle accueillie par l'auteur des Misérables? Comment la fragile Adèle aura-t-elle vécu ce passage aux Antilles et supportera-t-elle son retour au bercail? Raphaël Confiant dresse deux beaux portraits de femmes et nous révèle, dans une langue riche des sonorités de toutes les langues parlées aux Antilles (français, créole, anglais, espagnol, hollandais, etc.) une des facettes, insoupçonnée, du choc entre l'Ancien et le Nouveau Monde... Biographie de l'auteur ici. ExtraitIl n'est pas vrai qu'il suffit de porter à l'oreille une conque de lambi au rose nacré pour entendre les rumeurs de l'Archipel. On n'y perçoit que musiques indéchiffrables et douleurs inapaisées. Celles-ci jaillissent du Tout-Monde, de l'Afrique-Guinée à jamais perdue, de l'Europe, implacable vigie qui n'a de cesse de ricaner avec tant et tellement de hautaineté. D'autres terres aussi dont j'ai peine à prononcer les noms et à imaginer l'étendue. Il n'est pas vrai non plus que l'immense houle, née des cyclones de septembre, furibonde depuis l'île de la Barbade jusqu'à Jacmel, en Haïti, ou bien encore Santiago de Cuba où ma mère, ô incertain de la rumeur, aurait fini ses jours en sainte femme. À ce qu'il paraît, un petit autel honore sa mémoire parmi les divinités féminines du vaudou, à la droite d'Erzulie, je présume, celle dont la belleté est un défi à l'arc-en-ciel. Pourtant, elle s'appelait en toute simplicité Carmen Conchita Alvarez, n'ayant jamais voulu, en dépit de quatre mariages — contractés à la vivement-dépêché, il est vrai —, brocanter de papiers d'identité. Je me souviens d'elle si fière qui s'en allait proclamant sur les ports et les places publiques: «Je suis tout entière dans mon nom! Je suis mon nom. Avilissez mon corps, enfermez-moi dans vos geôles fétides, accusez-moi de tous les péchés véniels et mortels de la terre, mais ne touchez pas à ce qui me vient des Royaumes de Castille et d'Aragon.» C'est que ma mère, quand son négoce de pacotille donnait des signes d'essoufflement, vendait son devant au plus offrant (ce qui ne veut pas dire au premier venu, non!), la bouche pleine de morgue, les poings sempiternellement fichés sur les hanches, tout en supportant sans broncher les avanies de bourgeois en goguette qui, une fois satisfaits, lui éructaient au beau mitan de la figure : «Hors de ma vue, Négresse noire comme hier soir! Où a-t-on jamais vu des créatures aussi démoniaques que toi dans la blanche Espagne?» Il est vrai, par contre, que mon nom à moi est Céline Alvarez Bàà et que, moi aussi, je l'habite tout entier. Chacun des mots qui le compose est une histoire. Celle de mes aïeux d'abord — honneur et respect sur leur tête! — tous, quels qu'ils soient. Celle de l'Archipel ensuite où toutes les nations de la terre se sont ruées. La mienne enfin; mon histoire faite de drivailles, d'errances, d'espoirs irraisonnés, de déceptions sans-manman. Je n'ai eu cesse de te conter tout cela, pauvre chère Adèle, n'ayant jamais désespéré qu'un jour la raison se déciderait à regagner ton esprit, y chassant du même coup les miasmes de cette funeste passion qui le dévorait. Je ne t'ai pas crue une miette de seconde lorsque, t'ayant recueillie, errante dans une ruelle du port de Bridgetown, en l'île de Barbade, tu m'as déclaré avoir pour père le plus grand poète de ce pays aux contours pour moi irréels qu'est la France. Haillonneuse, maigre jusqu'à l'os, tremblotante des lèvres et des mains, un feu inconnu brillait dans le grain de tes yeux qui m'a, irrésistiblement, attirée vers toi, spectre égaré en plein jour. La foule s'esclaffait, te voltigeait des chapelets de moqueries dans cet anglais rauque de la Barbade qu'on affirme hérité des premiers colons écossais. Indifférente à ses criailleries, tu tournevirais et tournevirais, bras à l'horizontale dans ce qui te restait de vêture — une robe de mariée cent fois rapiécetée mais, incroyable plus qu'incroyable, immaculée ainsi qu'un incongru manteau d'hiver — et tout cela baillait l'impression que tu étais sur le point de prendre ton envol, flap! Il était midi, heure préférée du Diable sous le soleil raide des îles, et le spectacle que tu offrais était fascinant. «Je ne suis pas la pauvresse que vous croyez, ladies and gentlemen, ressassais-tu, le coin des lèvres dégoulinant d'une bave mauvaise. Je ne suis non plus ni une pécheresse condamnée à l'exil perpétuel ni une de ces orphelines brusquement happées par le dénantissement, ce qui rassure quant à leur humanité vos faces de Nègres hilares, vous qui n'aimez rien tant, n'est-ce pas, que de voir la race supérieure chuter de son piédestal. Je ne suis rien de tout cela. Je suis Adèle Hugo, la fille du plus éminent versificateur de l'univers, celui dont on chuchote les poèmes dans les plus humbles chaumières comme dans les cours royales. Celui dont tous les marins du monde égrènent en leur for intérieur l'Oceano Nox chaque fois qu'ils prennent la mer.» Deux Nègres se gourmaient pour ta personne. Deux Nègres chargés d'enrageaison. Deux chiens qui éructaient. Un colosse quinquagénaire armé d'un bec d'espadon-mère,'air redoutable, le crâne à moitié chauve et un jeune gandin plutôt mince et beau garçon qui fiéraudait, muni pourtant d'un misérable canif qui avait tout l'air d'un jouet. Ils tournoyaient sur un ring invisible, cherchant à s'approprier ta personne, la tirant sans ménagement vers eux, la perdant, puis la rattrapant, tout en faisant mine de se frapper avec leurs armes respectives. Dans l'envoyer-monter de leurs invectives, ils révélaient au public, par bribes, dans quelles circonstances chacun d'eux avait trouvé «cette jeune Blanche» et se l'était arrogée. Selon le premier, elle s'était assommeillée dans son canot de pêche où il l'avait découverte un beau matin, transie par la rosée, tandis que le second racontait une histoire de bal populaire au cours duquel vous auriez dansé toute la nuit bras-dans-bras. N'ayant cure de leurs bravacheries, indifférente aux menaces qu'ils proféraient et aux armes qu'ils brandissaient, tu leur répétais sans arrêt: «Les mots de mon père font trembler la Muraille de Chine, déborder le fleuve Congo, vaciller le Chimborazo, tressaillir la mer d'Irlande et c'est pourquoi je me trouve ici parmi vous. J'ai voyagé jusqu'à la Barbade sur les ailes de ses muses!» Il a suffi de ces quelques mots comiquement assenés pour que je me décide à t'adopter. Il y avait beau temps que je rêvais d'avoir un enfant à moi. Chaque homme rencontré m'était un espoir fou. Dans chaque île, j'en possédais un qui se morfondait de m'attendre des semaines, voire des mois durant. Il y eut le bel Anthony MacAllister, Nègre de Trinidad à la taille de pied-coco qui promenait sa tristesse dans les caboulots de Port of Spain, guettant quelque nouvelle par-ci par-là. La preuve que j'étais encore en vie. «Car comment Céline Alvarez Bàà peut-elle passer inaperçue?» tonnait-il lorsqu'il était fin saoul au tafia-gin-absinthe. «Sa membrature est si puissante qu'elle vous barre la lumière dès qu'elle se tient en face de vous. Ses hanches sont si larges et fermes, son giron si tentateur qu'on meurt d'envie de s'y plonger séance tenante. Et je n'évoque même pas ses bras d'ébène pur, ses seins si haut dressés qu'ils intimident l'homme le plus guerrier et quant à l'étalage de ses dents, on jurerait des éclats de lune!» Habitué à ce batelage d'amoureux au désespoir, la faune des bas quartiers haussait les épaules quand elle ne se gaussait pas de lui. Parfois, mon Anthony se faisait rosser par quelque matelot vénézuélien au sang chaud sans que cela infligeât un coup d'arrêt à sa litanie. Il insistait au contraire: «Baillez-moi des nouvelles de ma Négresse, goddam! Je sais que vous la connaissez. Elle charroie dans ses paniers l'inouï des richesses du monde.» Tout cela m'était rapporté à chacune de mes escales dans son pays et avait, bien entendu, le pouvoir de m'attendrir. Il y eut Michel Audibert, un mulâtre de la Martinique, toujours vêtu en dimanche, qui se déplaçait avec une canne à pommeau argenté tout en brodant un français Grand Siècle. Il distribuait avec libéralité sa carte, ornée de lauriers, qui portait la sobre inscription suivante: M. Audibert, homme de lettres, 37, rue du Petit-Versailles (1er étage), ville de Saint-Pierre, Antilles françaises. Dès qu'il venait m'accueillir au port, je le reconnaissais à son panama curieusement enrubanné de mauve parmi la badaudaille qui se pressait sur les quais. Il me taquinait avec gentillesse sur ma prononciation du r, tantôt trop hispanique à son gré, tantôt trop feutrée, trop britannique. «De retour déjà!» me lançait-il en me faisant un baisemain et en grasseyant le début du deuxième mot comme pour insinuer, une fois de plus, que toute Céline que je me prénommais, ma lointaine ascendance française du côté paternel était pure vantardise. Il m'écrivait, de loin en loin, des poèmes sibyllins que je portais sur moi en guise de viatiques. Il y eut aussi Diego, natif de San Juan, roi de Porto Rico et de ses casinos avec sa fine moustache qu'il taillait avec soin au réveil avant même d'avaler son sacro-saint café cueilli dans les montagnes de son île. Il insistait pour que je lui tire les cartes, me croyant, malgré mes véhémentes dénégations, liseuse d'avenir. Moi qui ne suis, résistais-je, que pacotilleuse, modeste marchande de miroirs ciselés, de fers à défriser les cheveux, de tissus en calicot ou en popeline, de poudres réputées guérir en six-quatre-deux diarrhées, maux de tête et chagrins d'amour, de coutelas et de canifs-Sheffield, de farine de manioc et de cigares gros comme l'avant-bras. Je déballais alors mes paniers caraïbes à même le trottoir et brandissais triomphalement, tour à tour, d'autres trésors: culottes noires qui protègent contre les assauts des incubes pour peu qu'on les porte à l'envers, bibles reliées de cuir, Petit Albert et Grand Albert, pots de vaseline, colliers de vraies et fausses perles ou almanachs aux couleurs criardes. Incrédule, Diego, qui se vantait d'être l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu de Christophe Colomb, me regardait faire et, attendant que les passants aient fini de me dévaliser, caressait d'un geste rêveur ma bourse lestée de pesos et se mettait à me chanter un boléro. Puis, retrouvant soudain sa sérieusité, il m'entraînait au mausolée du Grand Amiral de la Mer océane où il tenait à se recueillir au moins une fois par semaine. Et que je n'oublie point Ti Jacques, natif-natal d'Haïti, étudiant en philosophie le jour qui portait aux nues un certain Schopenhauer, gardien, à la nuit close, de la vaste demeure patricienne d'un juge de paix, sur les hauteurs de Kenscoff, là où il règne une telle freidure qu'on est obligé de se draper d'une couverture en laine. Il s'acharnait à m'enseigner'histoire, à ses yeux glorieuse, de son pays, deuxième de toute l'Amérique à s'être libéré du joug européen, juste après les États-Unis, et première république noire du monde moderne. «Le 1er janvier 1804, soliloquait-il, quand le généralissime Jean-Jacques Dessalines décréta l'indépendance de notre patrie en la ville de Gonaïves, le petit Napoléon connut sa première grande défaite. Ha-ha-ha! Cinquante mille soldats en déroute. Son beau-frère, le général Leclerc, époux de Pauline Bonaparte, contraint de s'enfuir comme une mangouste sur ce qui lui restait de flotte. L' esclavage définitivement aboli!» Voyant que je buvais ses paroles, il tempérait aussitôt mon admiration en ajoutant à voix basse, non sans avoir jeté un regard circulaire et inquiet autour de nous: «Pourtant, rien n'a vraiment changé pour les Nègres de petite extraction comme moi. Rien. Seule la figure de nos maîtres est devenue différente, hélas. Heureusement qu'il nous reste la force vaudoue!» Puis, reprenant une voix normale: «Tu n'aurais pas dix gourdes à me prêter, chérie-cocotte-l'amour? Ou bien dix shillings, si tu préfères. Seulement dix, s'il te plaît... » Et puis, il y eut tant d'autres! Ceux qui continuent à me hanter: John-Thomas, chercheur d'or dans les entrailles de l'Amazonie; le marquis de Châteaureynaud qui voulut, fol d'entre les fois, restaurer la plantation de ses aïeux au cœur de l'Artibonite. Ceux dont j'ai parfois enterré les noms sous les cendres de mes souvenirs. Aujourd'hui que je suis vieille et cassée, à la veille de mon retour définitif aux Antilles — sans doute mon dernier grand voyage —, j'avoue ne retenir de mes inumérables ébats que la fougue de ton père, Victor Hugo, pourtant déjà accablé par les ans et chenu, qui m'obligeait à l'appeler le Centaure lorsqu'il me labourait les chairs sur la table de la cuisine sans même se dévêtir. Je frémis au seul souvenir de la rage sourde qui émanait de ses coups de reins, aux grognements de satisfaction qu'il laissait échapper au moment de l'extase charnelle. Tant de sauvagerie et de bonté à la fois chez un seul et même homme me stupéfiait et j'ai gardé en tête, l'intact des versets qu'il m'avait enseignés afin d'agrémenter nos fortuites étreintes:
Simplement, si Hugo soutenait bien la comparaison avec le roi de la forêt, moi, Céline Alvarez Bàà, j'étais loin d'être ce volatile pétri d'innocence qu'il voyait en moi. J'étais tout au contraire l'oiseau-mensfenil. Celui qui parade si-tellement haut qu'on le croirait fils du soleil, mais, attention, foutre!, en un battement d'yeux, il peut fondre sur sa proie, à la verticale de quelque savane isolée, et l'emporter entre ses griffes. La chiquetailler et la dévorer même en plein vol. Seulement, le poète a-t-il jamais su qui j'étais vraiment? Dans ses rares moments de tendresse, il me murmurait aussi des paroles sirop-miel, telles que «ma Mauresque au regard d'ambre», que j'avais la faiblesse de prendre pour une marque d'amour. * À son arrivée à Charleston, le détective Henry de Montaigue s'inquiéta, comme à chacune de ses étapes, de l'état de ses bagages, non qu'il voyageât lourd mais bien parce que ses deux sacs en cuir, fermés par des cadenas, intriguaient marins, portefaix, douaniers et bien sûr gens de police. Dans le premier, il transportait ce qu'il répugnait à qualifier de garde-robe, par dignité masculine, quoiqu'il contînt chemises en soie, pantalons de flanelle, lavallières à l'anglaise, caleçons de pur coton et socquettes blanches filées par sa mère pour le confort de son fils unique, l'ultime héritier de la famille, l'honneur des De Montaigue, comme le serinait un grand-oncle que la mort avait oublié. En fait, ceux-ci n'avaient plus, depuis beau temps, de nobliau que le patronyme et un restant de respect de la part des villageois de Fortenelle dont certains continuaient, la belle saison venue, à apporter à ce qu'ils nommaient encore le «manoir» — bâtisse certes vaste mais plutôt décrépie — les premiers fruits de leurs jardins. Henry avait donc été élevé dans une atmosphère de lente mais inexorable décadence familiale, non qu'il eût jamais à souffrir de la moindre privation, mais parce qu'il lui arrivait de surprendre sa mère, tard dans la nuit, en train de faire et de refaire les comptes de leurs propriétés, le front soucieux, inconsolable de la perte précoce de son mari. Il n'en restait pourtant plus grand-chose: une quinzaine d’hectares plantés en vigne…
LITTERATURE - Jeudi 22 Septembre 2005 - Justice n°38 - Page 12Raphaël Confiant, écrivain à l’imagination intarissable, vient de publier au Mercure de France un dernier roman intitulé “Adèle et la pacotilleuse”. Cette œuvre captivante raconte l’histoire poignante d’Adèle, fille de l’écrivain romantique Victor Hugo partie en Amérique à la recherche de l’officier britannique Albert Pinson dont elle est follement amoureuse. Folle d’amour, Adèle l’est en effet, au point de parcourir de longues distances, allant de garnison en garnison, bravant mille dangers pour un homme qui ne l’aime pas et dont le lecteur finit par se demander s’il n’est pas qu’une pure chimère. Dans Pile de la Barbade, la Pacotilleuse Céline Alvarez Bàà, femme-matador d’ascendance à la fois africaine, espagnole et caraïbe, femme au grand cœur également, la prend sous sa protection et l’amène vivre avec elle à Saint-Pierre de la Martinique. Après bien des péripéties, Céline parvient à entrer en contact avec Victor Hugo, à qui elle ramène Adèle, dont la folie, hélas est irrémédiable. Céline, bien que devenue la maîtresse de Victor Hugo, homme à l’appétit sexuel démesuré, se voit contrainte de regagner les Antilles, d’où elle repartira plus tard pour im second voyage à Paris afin de soulager la détresse morale et psychologique de sa “fille” Adèle. Raphaël Confiant confirme son immense talent de romancier avec “Adèle et la pacotilleuse”. Outre le portrait de ces deux femmes au destin hors du commun, il nous offre une magnifique fresque de la Caraïbe au XIXe siècle. La pacotilleuse, symbolisée par Céline Alvarez Bàà, mais représentée aussi par d’autres figures non moins attachantes est, à cette époque, un lien puissant entre les différentes îles des Antilles d’une part, et entre celles-ci et le continent américain, d’autre part. Sous la plume de Confiant, la grande Caraïbe devient réalité vivante, univers à la fois hétérogène et homogène, avec sa diversité linguistique, une diversité perçue comme un atout plus que comme un obstacle, du moins par Céline Alvarez Bàà, qui passe aisément de l’anglais à l’espagnol, de l’espagnol au français ou au créole. Bien que le thème de l’errance domine le roman, l’action se déroule en grande partie dans la ville de Saint-Pierre, le “Petit Paris” des Antilles. Là, on découvre la société coloniale, avec sa division en castes, ses préjugés raciaux, mais aussi sa joie de vivre, son penchant pour le sexe et la poésie. Pour faire revivre ce XIXe siècle, l’auteur choisit de laisser la parole à ses personnages principaux, lesquels sont promus narrateurs, au même titre que ce narrateur à la troisième personne dont la voix semble se confondre avec celle de Confiant lui-même. La langue est belle, avec quelques expressions créoles francisées et certains mots inventés à la manière créole, ce qui aboutit à un français littéraire singulier, non dénué de charme. Un point mérite d’être souligné à propos de ce roman et des autres romans de Confiant ils sont certes tous le fruit d’une imagination fertile, mais cette imagination ne pourrait s’épanouir sans un énorme travail de documentation tourné essentiellement vers le passé. M. Belrose Raphaël Confiant mignonne la languePar MOHAMMED AÏSSAOUI Les responsables du Petit Robert ou du Larousse devraient se dépêcher d'embaucher Raphaël Confiant. C'est un fabuleux inventeur de mots, dont les néologismes sont chargés de sens, et «parlent» aux amoureux du langage. Tenez, un exemple parmi tant d'autres. Dans l'histoire qu'il narre, l'auteur glisse un verbe ignoré des dictionnaires récents, celui de «mignonner» – «Elle lui mignonne les joues» –, qui serait une variante de caresser. Et, miracle, le lecteur comprend tout de suite. Le livre ne manque pas, non plus, d'expressions savamment troussées. Ainsi, lorsque les circonstances exigent de se faire tout petit, l'écrivain préfère écrire que «chacun rentre dans sa chacunière» ; ou, encore, lorsque l'héroïne respire avec force, il parle du «monter-descendre de ses seins». L'auteur créole ravive le verbe et ressuscite des termes désuets. Voilà pour la forme et le style chatoyant, et déjà l'ouvrage mériterait que l'on s'y plonge pour cette raison. Continuation ici. Ce n'est pas une révélation, Raphaël Confiant est un conteur-né. Il le prouve encore en choisissant Adèle Hugo pour héroïne. Valérie Marin La Meslée Et si l'un des écrivains les plus audacieux de la littérature contemporaine se nommait Raphaël Confiant? La lecture de son nouveau roman, «Adèle et la pacotilleuse», donne toutes les raisons de confirmer ce qu'une oeuvre prolixe (près de vingt titres) a depuis longtemps démontré en matière d'inventivité. Trouvaille du sujet, déjà: aller repêcher, au coeur du XIXe siècle, cette historique Madame Bàà qui, de l'île de la Barbade où elle recueille l'errante Adèle Hugo, va la prendre sous sa protection, la «douciner» un peu, puis la ramener en France à son vieux père. S'emparer de cette négresse de Céline, une de ces «mâles-femmes» dont Confiant a le secret, vendeuse de pacotilles, pour imaginer sa relation maternelle, sensuelle, généreuse, avec la fille cadette du grand Hugo, si malade de son amour fou pour ce lieutenant anglais de Pinson et réinscrire ici cette aventure improbable dans le contexte des Caraïbes et de la France. Quel talent de conteur et quelle «savance» il faut là, distillée pourtant si légèrement. Se risquer à prendre Victor Hugo pour personnage, confronté, lui aussi, à l'exil dont il est juste de retour quand il retrouve sa fille. Et peindre un vieux grand homme meurtri mais tout vert encore quant aux plaisirs de la chair, goûtés, via Céline, avec sa «première négresse», comme le révèlent ses carnets intimes. L'Histoire est la grande compagne en création de Confiant, c'est elle qu'il a senti vibrer enfant, né en Martinique en 1951, au basculement du temps des plantations vers celui du tourisme. C'est par elle qu'il ancrera la littérature comme patrimoine de sa terre natale et nous donnera à lire les Antilles du XVIIIe siècle comme celles des années 60: encore récemment (dans «La panse du chacal»), il a révélé une page du néo-esclavagisme en embrassant le destin des Indiens immigrés en Martinique. Mais, de local, ce patrimoine nous devient de plus en plus universel et proche, par les croisements des cultures et des langues dont son dernier roman bruit à chaque phrase. .... Céline, sa pacotilleuse, incarne, avec cent cinquante ans d'avance, un métissage pour le meilleur de nos sociétés. Et sa rencontre avec le patrimoine des lettres françaises montre à quel point il est temps pour le lecteur de recevoir d'ailleurs pour se lire autrement. Avec tout le bonheur que lui donnera Confiant, en «trouvailleur» de génie Article entier ici.
|
| |
|||
| |