| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
Lire Camus à 18 ans et à 52 ans 25. mars 2023
|
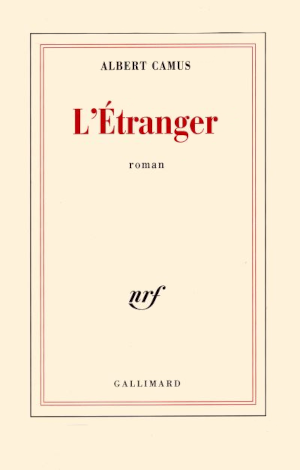 |
Ce qui demeure bien sûr, c’est la beauté des textes, tous ces mots parfaitement maîtrisés qui se déploient sur la page et dans mon imaginaire.
«L’Étranger» et son lyrisme contenu, les mots tranchés, ciselés, d’une précision inouïe, «L’été, retour à Tipasa» et son lyrisme libéré, des mots qui sont incantations et prières, qui célèbrent la jouissance de l’être dans la matière ou encore «Le premier homme», des pages et des pages qui disent le travail de la mémoire et celui des mots. Je continuerai à lire Camus, sans doute jusqu’à l’orée de la mort, parce que le français, plus qu’aucune autre langue, résonne en moi. Cette langue triture ma chair, elle la bouscule et la violente, elle m’ouvre un univers de possibles et de finitudes. C’est un amour contrarié et une défaite consentie.
Puis, il y a tout ce qui a changé.
À dix-huit ans, on a les yeux tournés vers l’Occident, qui symbolise alors l’altérité désirable, la culture, la science, les horizons du dépassement. Ce sont des fantasmes évidemment, mais qui puisent dans un puissant rapport de domination, économique, politique et culturel. Une domination qui produit un écrasement du psyché du dominé, le faisant souvent ignorer sa propre condition. Et cette problématique demeure de nos jours. Comment envisager de penser hors de l’Occident, comment construire un autre paradigme quand tout nous vient de l’Occident? On adhère à ses révoltes, à sa radicalité, à ses lubies et à ses conformismes. Et Camus, à dix-huit ans, incarne cela. D'abord, cette langue que j'apprends à aimer, qui s'accorde aux nuances de mon être, puis les vitalités de la séduction de la pensée prométhéenne, loin des carcans de la tradition, de la pensée figée, d'un monde fini. Il faudra donc partir, aller à la conquête de la langue, de l'autre, aller là-bas parce que c'est là-bas qu'on apprend à être, qu'on peut être. Dix-huit ans, c'est l'âge des ambitions naïves et de la lucidité absente, ces combustibles nécessaires à la vie.
Puis il y a les chocs, les lectures de Said, Fanon et plus récemment de Wael Hallaq. Et je comprends que le voyage de la périphérie au centre ramène inéluctablement le colonisé à la périphérie, à ce qu'il est, à la figure de l'autre, de la différence. Il peut certes trouver sa place au centre, il peut s'y épanouir, sortir de sa condition d'indigène, mais il ne pourra y être qu'en se soumettant aux diktats de l'ordre dominant. Ils sont nombreux à jouer ce jeu, parfois par cynisme ou parce qu’il faut survivre ou parce qu’on n’a pas le choix mais aussi parce que dans le cœur inquiet du colonisé, il y a un désir inavoué mais viscéral, que le dominant reconnaisse son humanité, qu'il est, malgré ses complexes et ses doutes, à la hauteur, qu'il est à sa place parmi "nous".
Dis-moi ce que je suis et je te dirai ce que tu veux entendre.
Et graduellement, l'Occident se dévoile dans sa nudité. Et le spectacle est loin d'être beau. Il est souvent atroce. Les esprits sages te diront qu'il faut éviter la pensée binaire, se libérer des clivages simplistes. Et qu’on ne peut déconstruire le centre qu’en étant au centre. Ils ont raison, mais on ne se remet pas de cette nudité non voulue qui révèle une chair maladive et hypocrite, qu'on ne veut pas, qu'on refuse de voir, mais qu'on est néanmoins contraint de voir.
La beauté des mots demeure, bien sûr.
Mais à cinquante-deux ans, je lis Camus autrement. Ce qui me frappe, c'est l'absence, telle un trou noir qui dévore toute matière, de l'Arabe, personnage quasiment invisible qui sert de décor et de prétexte à l'existence du colon. Cette invisibilité s'explique par le fait que la domination nous autorise cet aveuglement envers l'autre. Mais plus encore, l'absence de l'Islam. Comment expliquer que cet écrivain, qui a grandi en Algérie, en terre d'Islam, qui y a vécu longtemps, n'en parle jamais ou presque? Dans ses écrits philosophiques, il ne cite que les penseurs occidentaux, cette pensée qui est ultimement tronquée, réinventée, blanchie pour écarter l'autre, auquel elle doit tout ou presque. Pourquoi cet écrivain dont lucidité est fulgurante est-il incapable de faire preuve de lucidité dans ce cas? Parce qu'il est un écrivain européen en terre conquise. Parce qu’il est enraciné dans un paradigme dominant. L'écriture de Camus, comme je l'ai souligné plus tôt, est un trou noir qui réunit l'étrangeté de l'absence à la certitude des paradigmes de la domination. Mais il faut aller plus loin. On avance que la décolonisation est une appropriation et subversion de la littérature sans remettre pour autant le concept de la ‘littérature’ comme une forme de sacralité qui est le produit d’une contingence historique, la sécularisation de l’Occident. La divinisation des mots est rendue possible par la suppression du divin. A 52 ans, Camus n’est plus la substance orgiaque de la plénitude mais une coquille éviscérée de sa matière, péniblement vide. Mais les mots demeurent.
Ce cheminement m'a mené de la naïveté à la lucidité ou est-ce d'un déni de lucidité à une possible lucidité? La question maintenant est de savoir si on peut se liberer de ses aveuglements. Camus a écrit que ‘le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte.’ Cette liberté absolue qui est un acte de révolte est cependant ailleurs, dans un autre lieu, un autre paradigme, un lieu étranger, qu’il reste encore à imaginer, à inventer.
Umar Timol
*
